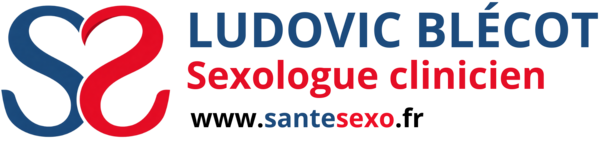Comment l'implant contraceptif fonctionne-t-il et est-il efficace ?
Introduction
L'implant contraceptif figure aujourd’hui parmi les méthodes de contraception hormonale les plus fiables et les plus discrètes. Conçu pour offrir une protection de longue durée sans intervention quotidienne, il séduit un nombre croissant de femmes, notamment parmi les jeunes, les professionnelles, ou celles en post-partum.
Mais derrière sa promesse de simplicité se cachent des mécanismes complexes, des bénéfices reconnus, et des effets secondaires qu’il convient de bien comprendre.
Cet article propose une analyse détaillée de son fonctionnement, de son efficacité, de ses indications, mais aussi des précautions à connaître pour en faire un choix contraceptif éclairé.
Qu’est-ce que l’implant contraceptif ?
Définition et présentation
L’implant contraceptif est un petit bâtonnet flexible, de forme cylindrique, mesurant environ 4 cm de long pour 2 mm de diamètre. Conçu pour une insertion sous-cutanée, il est généralement placé dans la face interne du bras non dominant, à l’aide d’un applicateur préchargé, et sous anesthésie locale. Sa présence est presque imperceptible une fois inséré.

Classé dans les méthodes de contraception hormonale longue durée et réversible (Long Acting Reversible Contraceptives – LARC), l’implant libère en continu un progestatif dans l’organisme, garantissant une action prolongée sans dépendre d’une prise quotidienne. Il constitue ainsi une alternative de choix aux pilules progestatives, notamment pour les personnes présentant des difficultés d’observance.
À lire aussi : Quelle est la meilleure option : pilule, implant ou injection progestative ?
Les implants disponibles en France
En France, un seul modèle d’implant est actuellement commercialisé : Nexplanon®. Il s’agit d’un implant contenant 68 mg d’étonogestrel, un dérivé du désogestrel, hormone progestative utilisée également dans certaines pilules. Sa durée d’action contraceptive est de trois ans.
Nexplanon® est pris en charge à 65 % par l’Assurance maladie. Il peut être prescrit et posé par des médecins, des sages-femmes et, dans certains cas, des infirmier·ères en pratique avancée. Il peut être délivré anonymement et gratuitement aux mineures ou aux personnes sans couverture sociale, dans le cadre du droit à la contraception garanti par les lois de santé publique.
Comment fonctionne-t-il ?
Mécanisme d’action hormonal
L’efficacité de l’implant contraceptif repose sur la libération continue d’un progestatif, l’étonogestrel, dans la circulation sanguine. Cette hormone agit principalement en inhibant l’ovulation, c’est-à-dire en empêchant la libération mensuelle de l’ovocyte par les ovaires.
Par ailleurs, elle épaissit la glaire cervicale, rendant plus difficile le passage des spermatozoïdes à travers le col de l’utérus, et modifie l’endomètre, ce qui rend la nidation peu probable en cas de fécondation exceptionnelle.
Ces trois mécanismes conjugués expliquent la très haute efficacité contraceptive de l’implant, sans dépendance à une action volontaire quotidienne.
Comparaison avec d’autres méthodes progestatives

L’implant se distingue des pilules progestatives, qui exigent une prise quotidienne stricte, et des injections trimestrielles, qui nécessitent un renouvellement tous les trois mois.
Contrairement au DIU hormonal qui agit principalement localement dans l’utérus, l’implant exerce une action systémique, avec des effets homogènes sur l’ensemble de l’organisme. Sa libération hormonale stable et prolongée en fait une option particulièrement adaptée aux personnes souhaitant une contraception discrète, efficace et sans gestion régulière.
Sur le même sujet : Comment fonctionnent les contraceptifs progestatifs ?
Quelle est son efficacité ?
Taux de grossesse : données chiffrées
L’implant contraceptif est considéré comme l’une des méthodes les plus fiables actuellement disponibles. Son indice de Pearl, indicateur standard de l’efficacité contraceptive, est estimé à 0,05 %, soit moins d’1 grossesse pour 2 000 femmes utilisant ce moyen durant un an.
Cette efficacité exceptionnelle s’explique notamment par l’absence de dépendance à l’observance : contrairement à la pilule, l’implant ne nécessite ni prise quotidienne, ni renouvellement fréquent, réduisant ainsi les risques d’oubli ou d’erreur d’utilisation.
Selon l’OMS, il s’inscrit dans la catégorie des contraceptifs dits « très efficaces », au même titre que les DIU hormonaux.
Comparaison avec d’autres méthodes
En comparaison, l’indice de Pearl est de :
- 9 % pour la pilule progestative ou œstroprogestative en usage typique,
- 15 % pour le préservatif masculin en usage typique,
- 22 % pour la méthode du retrait,
- 0,8 à 1,1 % pour les dispositifs intra-utérins (DIU), selon qu’ils soient au cuivre ou hormonaux.
Autrement dit, l’implant est au moins 10 à 20 fois plus efficace que les méthodes les plus couramment utilisées, tout en offrant une tranquillité d’esprit prolongée.
Importance de la pose et du retrait
La fiabilité de l’implant dépend toutefois de la qualité de la pose. Celle-ci doit être réalisée par un professionnel de santé formé, selon un protocole strict. Une insertion incorrecte, une absence de vérification ou un oubli de retrait à échéance peuvent réduire son efficacité. Un suivi post-pose est donc recommandé, notamment pour s’assurer de la présence palpable de l’implant.
Quels sont les avantages de l’implant ?
Confort et oubli
L’un des principaux atouts de l’implant contraceptif réside dans son absence de contrainte quotidienne. Une fois inséré, il fonctionne de manière autonome pendant trois ans, sans qu’aucune action régulière ne soit requise. Ce confort libère la personne utilisatrice de la charge mentale liée à la contraception, notamment en cas de rythmes de vie irréguliers ou de difficulté à suivre un traitement oral.
Discrétion et confidentialité
Discret, invisible à l’œil nu, l’implant est placé sous la peau du bras non dominant, sans laisser de marque visible, si ce n’est une fine cicatrice ponctuelle. Il peut être posé sans que l’entourage n’en soit informé, ce qui constitue un avantage essentiel pour les jeunes ou les personnes dans des contextes où parler de contraception reste difficile. En France, l’accès à l’implant est gratuit et anonyme pour les mineures, renforçant cette confidentialité.
Efficacité sur le long terme
Avec une efficacité de 99,95 % et une durée d’action de trois ans, l’implant offre une protection contraceptive durable, sans risque lié à l’oubli ou à une mauvaise utilisation.
Réduction de certaines douleurs menstruelles
Chez certaines utilisatrices, l’implant peut réduire l’intensité ou la fréquence des règles douloureuses. Il est parfois recommandé en cas de dysménorrhées ou de troubles du cycle nécessitant une régulation hormonale.
Effets secondaires et inconvénients possibles
Troubles du cycle menstruel
Les modifications du cycle menstruel représentent l’effet secondaire le plus fréquent chez les utilisatrices d’implant contraceptif.
Environ une femme sur cinq rapporte une aménorrhée (absence de règles), tandis que d’autres connaissent des saignements imprévisibles, parfois prolongés ou répétés (spotting, métrorragies). Ces variations, bien que bénignes sur le plan médical, peuvent être mal vécues sur le plan psychologique ou social. Elles constituent la première cause de retrait anticipé de l’implant, souvent dans les premiers mois d’utilisation.
Réactions locales ou systémiques
La douleur au point d’insertion est généralement transitoire, atténuée par l’utilisation d’une anesthésie locale. Plus rarement, des réactions inflammatoires, des ecchymoses ou des cas de migration de l’implant ont été signalés. Sur le plan systémique, certaines femmes rapportent des variations d’humeur, une acné plus marquée, voire des céphalées ou une baisse de la libido. Ces symptômes ne sont pas systématiques, et la littérature scientifique ne permet pas d’établir un lien de causalité direct dans tous les cas. Il convient toutefois de rechercher d’autres causes somatiques ou psychoaffectives en cas de plainte persistante.
Cas particuliers à surveiller
L’implant, bien qu’utilisable par la majorité des femmes, nécessite une attention particulière dans certains contextes médicaux.
Il est contre-indiqué en cas de thrombose évolutive, de cancer hormono-dépendant ou de saignements génitaux inexpliqués. Chez les personnes présentant un IMC élevé, certaines études ont évoqué une éventuelle diminution de la durée d’efficacité. Toutefois, les données restent limitées, et il n’est pas nécessaire de remplacer l’implant avant trois ans chez les femmes obèses. Enfin, certains médicaments inducteurs enzymatiques (antiépileptiques, millepertuis) peuvent réduire l’efficacité contraceptive. Dans ce cas, une contraception complémentaire est recommandée pendant et après le traitement.
Pour qui l’implant est-il recommandé ?
Adolescents et jeunes femmes
L’implant constitue une option particulièrement adaptée aux jeunes femmes et adolescentes, notamment celles exposées au risque d’oubli ou vivant dans un environnement où la contraception peut être difficile d’accès. Il offre une discrétion totale et une protection prolongée sans intervention quotidienne, ce qui en fait une méthode privilégiée dans les recommandations de santé publique pour cette tranche d’âge.

Femmes en post-partum ou allaitantes
L’implant peut être inséré dès le 21e jour après l’accouchement, y compris en cas d’allaitement, sans altérer la qualité du lait maternel ni perturber la lactation. Son efficacité immédiate, sa compatibilité avec l’allaitement et l’absence d’œstrogènes en font une solution contraceptive sécurisée pour les femmes en post-partum.
Femmes à risque d’oubli ou de contre-indications aux œstrogènes
Chez les femmes présentant des contre-indications aux œstrogènes (antécédents de thrombose, migraines avec aura, tabagisme après 35 ans), l’implant offre une alternative progestative sûre. Il est aussi indiqué pour celles qui rencontrent des difficultés à suivre une contraception orale, pour des raisons médicales, sociales ou cognitives.
Comment se passe la pose de l’implant ?
Consultation préalable
Avant toute pose d’implant, une consultation médicale est indispensable. Elle permet d’évaluer les antécédents médicaux, les contre-indications éventuelles et les préférences de la patiente. Cette rencontre est aussi l’occasion de présenter les différentes méthodes contraceptives disponibles, afin de garantir un choix éclairé. Un examen clinique incluant poids, tension artérielle et IMC est généralement réalisé.
Procédure de pose
L’implant est inséré sous la peau du bras non dominant, à l’aide d’un applicateur stérile à usage unique. L’intervention, rapide et peu douloureuse, est effectuée sous anesthésie locale en cabinet. Une bande de compression est appliquée après la pose pour limiter les ecchymoses. La contraception est immédiatement efficace si la pose est faite entre le 1er et le 5e jour du cycle. Sinon, une méthode complémentaire est recommandée pendant 7 jours.

Suivi post-pose et vérification
La patiente doit être en mesure de palper l’implant sous la peau. Un suivi peut être proposé pour vérifier la bonne tolérance, répondre aux éventuelles questions, et informer sur la date de retrait prévue trois ans après la pose.
Quand faut-il envisager le retrait ou le remplacement ?
Fin de validité
L’implant contraceptif Nexplanon® a une durée d’action maximale de trois ans. Au-delà de cette période, il doit être retiré ou remplacé pour maintenir une efficacité contraceptive optimale. Le retrait se fait en consultation, sous anesthésie locale, via une petite incision au niveau du site d’insertion.
Désir de grossesse
L’implant peut être retiré à tout moment, dès lors qu’un projet de grossesse est envisagé. La fertilité revient rapidement, parfois dès les premières semaines suivant le retrait, sans délai d’attente particulier.
Effets secondaires mal tolérés
En cas de troubles persistants du cycle menstruel, de douleurs, de variations d’humeur ou d’autres effets indésirables jugés invalidants, un retrait peut être envisagé après évaluation médicale. Il convient cependant d’écarter toute autre cause médicale avant d’attribuer ces symptômes à l’implant.
Conclusion
L’implant contraceptif combine efficacité remarquable, confort d’usage et discrétion, en faisant une option privilégiée pour de nombreuses femmes. Son absence de dépendance à une action quotidienne limite les risques d’oubli, tandis que sa compatibilité avec l’allaitement et son absence d’œstrogènes élargissent ses indications.
Cependant, sa pose nécessite un accompagnement médical rigoureux et une information complète sur les effets secondaires possibles et les cas particuliers à surveiller. Les troubles du cycle, bien que fréquents, sont rarement graves, mais peuvent être vécus comme gênants si la patiente n’y a pas été préparée.
En définitive, comme pour toute méthode contraceptive, le choix de l’implant doit être individualisé, fondé sur un dialogue de qualité entre la patiente et le professionnel de santé. La contraception ne saurait se réduire à une prescription : elle s’inscrit dans un projet de vie, un rapport au corps, et une exigence de liberté reproductive pleinement assumée.
Sources
Haute Autorité de Santé (HAS). Nexplanon – Avis d'efficience. 2015. https://www.has-sante.fr
Organisation Mondiale de la Santé (OMS). High rates of unintended pregnancies linked to gaps in family planning services. 2019. https://www.who.int
Cochrane Fertility Regulation Group. Power J. et al. Contraceptive efficacy of implants for preventing pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2020; CD001326.
Revue Médicale Suisse. Expérience de la contraception par implant hormonal. RMS 2403, 2002.
MSD Manuals. Implants contraceptifs sous-cutanés. Consulté en 2024. https://www.msdmanuals.com
CHU de Québec. Implant contraceptif – Informations à l’usage des patientes. Mise à jour 2023. https://www.chudequebec.ca
Inserm. Contraception : état des lieux des méthodes disponibles. 2022. https://www.inserm.fr
CNGOF. Contraceptions de longue durée : avantages et inconvénients. Journées nationales, 2013. https://cngof.fr
Vidal. Nexplanon : monographie du médicament. Base de données publique des médicaments. https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr