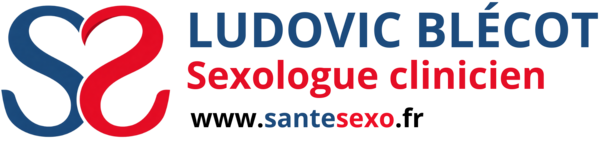Quelle est la meilleure option : pilule, implant ou injection progestative ?
Introduction
Dans le paysage contraceptif contemporain, les méthodes hormonales progestatives occupent une place essentielle. À la différence des contraceptifs combinés, elles ne contiennent pas d’œstrogènes et s’avèrent particulièrement adaptées à certains profils médicaux ou contextes de vie, comme l’allaitement, les antécédents thromboemboliques, ou encore les migraines avec aura.
Parmi les contraceptifs progestatifs disponibles, trois options se distinguent par leur popularité et leur efficacité : la pilule progestative, l’implant sous-cutané, et l’injection intramusculaire trimestrielle. Si leur efficacité contraceptive est globalement comparable en usage optimal, leurs modalités d’administration, leurs effets secondaires et leur tolérance varient largement selon les utilisatrices.
Cet article vise à comparer ces trois méthodes de manière rigoureuse, afin d’éclairer le choix des femmes et des professionnel·les de santé, en tenant compte à la fois des données scientifiques actuelles, des recommandations institutionnelles et des profils cliniques les plus courants.
Comprendre les contraceptifs progestatifs
Qu’est-ce qu’un contraceptif progestatif ?

Les contraceptifs progestatifs sont des méthodes hormonales ne contenant qu’un seul type d’hormone, dérivé de la progestérone naturelle. Contrairement aux contraceptifs combinés (œstroprogestatifs), ils sont dépourvus d’œstrogènes. Ce choix pharmacologique vise à limiter certains effets indésirables liés aux œstrogènes et à rendre la contraception accessible à des profils pour lesquels ces derniers sont contre-indiqués.
Ils existent sous différentes formes : pilules, implants sous-cutanés, injections intramusculaires, et dispositifs intra-utérins hormonaux.
À lire aussi : Comment fonctionnent les contraceptifs progestatifs ?
Quels sont leurs effets principaux sur le corps ?
Leur mécanisme d’action repose sur plusieurs effets synergiques :
- Inhibition de l’ovulation dans la majorité des cas, notamment pour les implants, injections et certaines pilules comme celles au désogestrel.
- Épaississement de la glaire cervicale, ce qui rend plus difficile la progression des spermatozoïdes dans le col de l’utérus.
- Modification de l’endomètre, qui devient moins favorable à la nidation d’un ovule fécondé.
- Réduction des contractions utérines, dans une moindre mesure.
Ces effets varient selon la molécule utilisée et la voie d’administration. Certains progestatifs à faible dose n’inhibent pas systématiquement l’ovulation mais agissent principalement par effet local sur la glaire cervicale.
À qui s’adressent-ils en priorité ?
Les contraceptifs progestatifs sont souvent préférés chez les femmes présentant une contre-indication aux œstrogènes, comme :
- les antécédents de thrombose veineuse ou artérielle,
- les migraines avec aura,
- certaines pathologies hépatiques,
- le tabagisme chez les femmes de plus de 35 ans.
Ils sont également adaptés en post-partum (y compris pendant l’allaitement), et souvent privilégiés chez les femmes de plus de 40 ans pour leur profil métabolique neutre.
Leur diversité permet un ajustement selon les préférences et contraintes de chaque personne : prise quotidienne, suivi trimestriel ou solution de longue durée sans action quotidienne.
Présentation des trois méthodes
Mode de prise et posologie
La pilule progestative, souvent appelée "micropilule", se prend chaque jour à heure fixe, sans interruption entre les plaquettes. Cette rigueur est essentielle : l’oubli de quelques heures peut suffire à compromettre son efficacité, notamment pour les pilules au lévonorgestrel, dont la tolérance à l’oubli est de 3 heures. Celles au désogestrel offrent une marge un peu plus large (jusqu’à 12 heures), tout en ayant un effet ovulatoire plus constant.
Avantages et inconvénients
Cette méthode est bien tolérée et peut être utilisée même chez les femmes présentant une contre-indication aux œstrogènes. Elle convient également pendant l’allaitement, dès 21 jours après l’accouchement.
Toutefois, son principal inconvénient réside dans l’exigence d’une observance rigoureuse. Les oublis fréquents en diminuent fortement l’efficacité. Par ailleurs, les troubles du cycle sont fréquents : spotting, saignements imprévisibles ou aménorrhée peuvent apparaître, et être source d’inconfort.
Cas particuliers
Certaines situations cliniques justifient des précautions spécifiques :
- Pathologies hépatiques sévères, antécédents de cancer du sein, ou saignements génitaux inexpliqués sont des contre-indications absolues.
- L’association avec le millepertuis est déconseillée en raison d’une baisse d’efficacité.
- Sur le plan économique, les pilules à base de lévonorgestrel sont remboursées à 65 %, alors que celles au désogestrel ne le sont généralement pas.
En somme, la pilule progestative peut convenir à des profils variés, à condition que la prise quotidienne ne constitue pas un obstacle.
Pour aller plus loin >> Comment choisir entre les pilules progestatives : micropilules et micro-dosées ?
Fonctionnement et durée d’action
L’implant contraceptif (NEXPLANON®) est un bâtonnet souple de 4 cm inséré sous la peau du bras. Il libère une microdose continue d’étonogestrel sur une durée de trois ans, empêchant l’ovulation et modifiant la glaire cervicale. Son efficacité est très élevée, même chez les femmes ayant un IMC élevé.
Procédure d’insertion et de retrait
L’implant est posé sous anesthésie locale au niveau de la face interne du bras non dominant, par un·e professionnel·le de santé habilité·e. Le retrait suit une procédure similaire, avec une incision minime. Sa pose peut avoir lieu immédiatement après un accouchement ou une interruption de grossesse.
Effets secondaires fréquents
Les effets les plus fréquents concernent le cycle menstruel : saignements imprévisibles, règles prolongées ou aménorrhée. Une prise de poids est signalée chez environ 40 % des utilisatrices à un an, nécessitant une évaluation si elle est importante. Rarement, des cas de migration de l’implant ont été rapportés.
À lire aussi : Quels sont les effets secondaires possibles de l'implant contraceptif ?
Ce contraceptif est remboursé à 65 % et constitue une option de choix pour les personnes recherchant une méthode fiable, durable et sans contrainte quotidienne.
Mode d’administration et durée d’effet
L’injection contraceptive repose sur l’acétate de médroxyprogestérone (DEPO-PROVERA®), administré par voie intramusculaire tous les 3 mois. Son action repose sur une inhibition durable de l’ovulation, accompagnée d’une modification de la glaire cervicale et de l’endomètre. Une injection unique suffit à assurer une contraception fiable sur une période de 12 semaines.
Suivi médical nécessaire
Cette méthode nécessite une surveillance régulière : les injections doivent être faites à intervalles stricts pour maintenir l’efficacité. Elle est contre-indiquée chez les femmes à risque vasculaire ou présentant des antécédents thromboemboliques. Elle n’est pas recommandée chez les adolescentes ou les femmes à risque d’ostéoporose en raison de son impact sur la densité osseuse.
Tolérance et retour à la fertilité
Parmi les effets secondaires les plus fréquents figurent des troubles du cycle (spotting, aménorrhée), une prise de poids importante (3 à 9 kg la première année), et un retard au retour de la fertilité, pouvant aller de 3 à 12 mois après l’arrêt. L’injection est remboursée à 65 %.
Elle peut convenir à certaines femmes, à condition d’être bien informées des délais de retour à la fertilité et des contre-indications spécifiques.
Comparaison des méthodes : avantages et limites
Efficacité contraceptive : quelles différences ?
Les trois méthodes offrent une efficacité contraceptive élevée en usage parfait. L’implant est la plus fiable (taux d’échec : 0,05 %), suivi de l’injection (0,3 %) et de la pilule (0,3 % en théorie, mais jusqu’à 2,4 à 9 % en pratique selon l’observance). En contexte réel, les méthodes à action prolongée et sans dépendance quotidienne (implant, injection) sont donc souvent plus fiables.

Facilité d’usage au quotidien
La pilule exige une prise quotidienne rigoureuse, ce qui augmente le risque d’oubli. À l’inverse, l’implant et l’injection libèrent les utilisatrices de toute gestion quotidienne. L’injection demande toutefois un suivi médical trimestriel, contrairement à l’implant qui fonctionne jusqu’à 3 ans sans intervention.

Réversibilité et retour de la fertilité
Le retour à la fertilité est immédiat après le retrait de l’implant ou l’arrêt de la pilule. Il peut être retardé de plusieurs mois après l’arrêt des injections, ce qui doit être anticipé par les femmes souhaitant une grossesse à court terme.
Effets secondaires courants
Les troubles du cycle sont fréquents avec les trois méthodes : spotting, saignements prolongés, aménorrhée. La prise de poids est plus souvent rapportée avec l’implant et surtout l’injection. Le risque de baisse de la densité osseuse est spécifique à l’injection.
Acceptabilité et confort selon les profils
Le choix dépend du rapport au corps, au cycle, et au confort personnel. L’implant est discret et durable. L’injection est périodique mais invasive. La pilule reste accessible mais contraignante. L’acceptabilité varie selon les effets perçus sur l’humeur, la libido ou la régularité des règles.
Comment choisir la bonne méthode ?
En fonction de l’âge et des antécédents médicaux
Les contraceptifs progestatifs sont particulièrement adaptés aux femmes de plus de 40 ans, ou à celles présentant des contre-indications aux œstrogènes (thrombose, migraines avec aura, tabagisme après 35 ans). L’injection est déconseillée en cas de risque vasculaire ou osseux. En post-cancer du sein, toute contraception hormonale est à proscrire.
En cas de pathologies (endométriose, migraines, etc.)
Les progestatifs purs sont souvent recommandés en cas d’endométriose douloureuse, notamment après chirurgie. Les migraines avec aura constituent une contre-indication aux œstroprogestatifs, mais pas aux progestatifs. L’implant et la pilule peuvent être utilisés pendant l’allaitement, dès 21 jours après l’accouchement.
Selon son mode de vie et ses préférences
Les femmes ayant une vie très active, des troubles cognitifs, ou en situation de précarité bénéficieront des méthodes de longue durée sans gestion quotidienne, comme l’implant. La pilule reste une option pour celles qui souhaitent garder le contrôle au jour le jour et n’ont pas de difficulté d’observance.
Ce que disent les recommandations officielles
Recommandations de la HAS et de l’OMS
La Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommandent de privilégier une information complète et un choix partagé entre professionnel·le et patiente. Les méthodes dites LARC (Long Acting Reversible Contraceptives), comme l’implant ou le DIU hormonal, sont particulièrement encouragées chez les adolescentes et les femmes à risque d’oubli, en raison de leur efficacité élevée en vie réelle.
Remboursements et disponibilité en France
Les trois méthodes progestatives sont remboursées à 65 %. Certaines pilules (lévonorgestrel) sont gratuites pour les mineures sur prescription. L’implant et l’injection sont disponibles sur ordonnance, et leur pose nécessite une formation spécifique pour les professionnel·les de santé.
Conclusion
Pilule, implant ou injection progestative : chacune de ces méthodes présente des avantages spécifiques, mais aussi des limites qu’il convient de connaître. L’implant se distingue par son efficacité et sa simplicité d’usage, tandis que la pilule reste une solution accessible à condition d’une bonne observance. L’injection, plus contraignante médicalement, peut convenir à certaines situations ciblées.
Le choix d’une contraception ne devrait jamais être laissé au hasard.
Une discussion personnalisée avec un·e professionnel·le de santé reste essentielle pour adapter la méthode aux besoins, au mode de vie et aux antécédents de chacune.
Sources
- Roux, A. L’histoire de la contraception. [Notes de cours].
- Vigoureux, S. Le contexte de la contraception en France. [Notes de cours].
- INED & INPES. La contraception en France : état des lieux et évolutions.
- OMS – CDC – HAS. (2019). Recommandations internationales sur la contraception.
- Linet, T. Contraception post-partum. [Notes de cours].
- Linet, T. La consultation de contraception. [Notes de cours].
- Linet, T. Contraception post-abortum. [Notes de cours].
- Pienkowski, C. La contraception de l’adolescente. [Notes de cours].
- Hamdaoui, N. Contraception d’urgence. [Notes de cours].
- Hassoun, D. Contraception naturelle et méthodes barrières. [Notes de cours].
- Robin, G. Contraception hormonale en pratique (hors DIU). [Notes de cours].
- Vidal, F. Contraception intra-utérine. [Notes de cours].
- Lambert, M. Contraception après 40 ans. [Notes de cours].
- Jonville-Bera, A.-P. Contraception et interactions médicamenteuses. [Notes de cours].
- Rousset-Jablonski, C. Contraception et cancer. [Notes de cours].
- Plu-Bureau, G. Contraception et risque vasculaire. [Notes de cours].
- HAS. Fiche mémo : contraception chez la femme à risque cardiovasculaire.
- Scheffler, M. Bénéfices non contraceptifs des contraceptions hormonales.
- Mieusset, R., & Soufir, J.-C. (2012). Guide pratique d’une contraception masculine. Article scientifique.
- Santé publique France. Première contraception chez l’adolescente. Outil d’aide à la décision
- HAS. (2013). Méthodes contraceptives : synthèse et recommandations.
- OMS. (2015). Critères d’éligibilité médicale pour la contraception, 5ᵉ édition.
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549158
- Vidal. (2024). Contraception hormonale : recommandations et fiches pratiques.
https://www.vidal.fr/maladies/recommandations/contraception-1626.html
- MSD Manuals. (2023). Méthodes de contraception hormonales.
- Question Sexualité – Santé Publique France. (2024). Les différentes méthodes de contraception.
- Inserm. (2022). Dossier thématique : Contraception.